![]() (2011) DEVI, Ananda, Les Hommes qui me parlent. Paris : Gallimard.
(2011) DEVI, Ananda, Les Hommes qui me parlent. Paris : Gallimard.
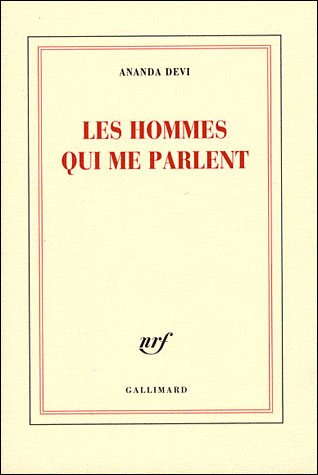 ÂŦ Tous ces hommes qui me parlent. Fils, mari, pÃĻre, amis, ÃĐcrivains morts et vivants. Une litanie de mots, dâheures effacÃĐes et revÃĐcues, de bonheurs rÃĐvolus, de tendresses ÃĐclopÃĐes. Je suis offerte à la parole des hommes. Parce que je suis femme.
ÂŦ Tous ces hommes qui me parlent. Fils, mari, pÃĻre, amis, ÃĐcrivains morts et vivants. Une litanie de mots, dâheures effacÃĐes et revÃĐcues, de bonheurs rÃĐvolus, de tendresses ÃĐclopÃĐes. Je suis offerte à la parole des hommes. Parce que je suis femme.
Puis-je changer de sexe et de corps ? Ne garder de moi quâune forme androgyne, asexuÃĐe, dÃĐbarrassÃĐe de ses propres besoins et du dÃĐsir des autres ? Car tout est là , finalement, la clÃĐ et le secret : Être un objet de dÃĐsir sur lequel sâengluent des formes autres, mensongÃĻres, conjurÃĐes par les fantasmes ou par les illusions, femme, mÃĻre, amante, proie inaccessible ou au contraire Être de faiblesse et de fragilitÃĐ, pourquoi ne pas tout dÃĐtruire dâun seul coup en disant : je suis un monstre ?
Mais il ne suffit pas de le dire. Il faut lâÊtre. Il faut le devenir. Cela mâest, hÃĐlas, impossible. Âŧ
(p. 11)
![]() (2009) DEVI, Ananda, Le sari vert. Paris : Gallimard.
(2009) DEVI, Ananda, Le sari vert. Paris : Gallimard.
 ÂŦ Le sari vert dÃĐployÃĐ dans la retraite de la crÃĐature vers sa chambre traÃŪne à terre, presque jusquâà nos pieds. Soie des souvenirs morts. Ils veulent fuir aussi, quitter le navire chavirÃĐ, oublier quâils se sont un jour amoureusement enroulÃĐs autour de ce corps qui a oubliÃĐ son innocence. Je me souviens quâelle vient dâavoir vingt ans. Vingt ans, et elle nâa toujours rien compris au mÃĐtier de femme ! Jâai envie de tirer sur le pan du sari pour le dÃĐtacher entiÃĻrement du corps, pour lâen libÃĐrer et peut-Être en garder quelque chose, un fragment de couleur et de douleur, mais au fond je ne ressens pas grand chose, cette femme est partie si loin de moi quâelle est dÃĐjà morte et câest une autre que je pleure.
ÂŦ Le sari vert dÃĐployÃĐ dans la retraite de la crÃĐature vers sa chambre traÃŪne à terre, presque jusquâà nos pieds. Soie des souvenirs morts. Ils veulent fuir aussi, quitter le navire chavirÃĐ, oublier quâils se sont un jour amoureusement enroulÃĐs autour de ce corps qui a oubliÃĐ son innocence. Je me souviens quâelle vient dâavoir vingt ans. Vingt ans, et elle nâa toujours rien compris au mÃĐtier de femme ! Jâai envie de tirer sur le pan du sari pour le dÃĐtacher entiÃĻrement du corps, pour lâen libÃĐrer et peut-Être en garder quelque chose, un fragment de couleur et de douleur, mais au fond je ne ressens pas grand chose, cette femme est partie si loin de moi quâelle est dÃĐjà morte et câest une autre que je pleure.
A ce moment, Kitty me demande : tu sais comment on punit les sorciÃĻres ?
Je la regarde, ÃĐtonnÃĐ de cette question.
Je ne sais pas, Kitty, lui dis-je.
Il faut les brÃŧler, dÃĐclare-t-elle. Âŧ
![]() (2007) DEVI, Ananda, Indian Tango. Paris : Gallimard.
(2007) DEVI, Ananda, Indian Tango. Paris : Gallimard.
 ÂŦ Au Xe siÃĻcle, en Inde, il y avait un moine bouddhiste appelÃĐ Ananda, qui appartenait à un ordre pratiquant une ascÃĻse extrÊme. Pendant une de ces pÃĐriodes d'austÃĐritÃĐ, aprÃĻs de longs jours de jeÃŧne, il avait aperçu par une fenÊtre du monastÃĻre une trÃĻs belle femme d'un village voisin, dont il ÃĐtait tombÃĐ amoureux avec la finalitÃĐ de celui auquel l'amour est interdit. Le visage et l'image de cette femme s'ÃĐtaient si profondÃĐment inscrits en lui qu'il s'ÃĐtait mis à la peindre et à la sculpter sans arrÊt, oubliant de prier, oubliant tous les rituels et les devoirs et provoquant la colÃĻre des supÃĐrieurs de son ordre. MalgrÃĐ les punitions infligÃĐes, il avait persistÃĐ Ã la dessiner et à la reprÃĐsenter sous toutes les formes, les unes plus suggestives que les autres. Comme il perturbait les autres moines par ses visions, on l'avait emmurÃĐ dans une caverne sous les montagnes voisines pour l'y laisser mourir. Au fil des annÃĐes, on l'y avait oubliÃĐ. Neuf siÃĻcles plus tard, un soldat anglais avait dÃĐcouvert la caverne par accident. Ãtant les pierres qui en bouchaient l'entrÃĐe, il avait vu sur tous les murs, au plafond et au sol, dans les recoins les plus inaccessibles, sur les aspÃĐritÃĐs et dans les anfractuositÃĐs, dans l'ombre rougeÃĒtre et sur les hÃĐmisphÃĻres mobiles, des formes ÃĐrotiques sculptÃĐes à mÊme la pierre, toutes reprÃĐsentant la mÊme femme. Parfois seule, parfois avec le moine, unis dans des postures impossibles. Le moine avait reproduit dans le noir les corps imaginÃĐs, innombrables de la femme interdite. Il l'avait rÊvÃĐe, caressÃĐe, accouchÃĐe de la pierre. Lorsque ses outils de fortune s'ÃĐtaient brisÃĐs, il avait continuÃĐ Ã la sculpter avec ses ongles et ses doigts et ses dents et son corps, il s'y ÃĐtait frottÃĐ jusqu'à l'usure, jusqu'à ce qu'il y laisse ses fragments et ses os, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de son corps qui ne soit tout entier incrustÃĐ dans ses sculptures. Il avait rÃĐussi à la possÃĐder, mÊme si c'ÃĐtait dans un univers de pierre. Il avait franchi l'espace qui le sÃĐparait du rÊve. Il avait recrÃĐÃĐ la rÃĐalitÃĐ selon ses dÃĐsirs. Il avait rÃĐalisÃĐ ce miracle dont rÊvent tous les artistes ; mais il fallait, pour cela, Être enterrÃĐ vivant.
ÂŦ Au Xe siÃĻcle, en Inde, il y avait un moine bouddhiste appelÃĐ Ananda, qui appartenait à un ordre pratiquant une ascÃĻse extrÊme. Pendant une de ces pÃĐriodes d'austÃĐritÃĐ, aprÃĻs de longs jours de jeÃŧne, il avait aperçu par une fenÊtre du monastÃĻre une trÃĻs belle femme d'un village voisin, dont il ÃĐtait tombÃĐ amoureux avec la finalitÃĐ de celui auquel l'amour est interdit. Le visage et l'image de cette femme s'ÃĐtaient si profondÃĐment inscrits en lui qu'il s'ÃĐtait mis à la peindre et à la sculpter sans arrÊt, oubliant de prier, oubliant tous les rituels et les devoirs et provoquant la colÃĻre des supÃĐrieurs de son ordre. MalgrÃĐ les punitions infligÃĐes, il avait persistÃĐ Ã la dessiner et à la reprÃĐsenter sous toutes les formes, les unes plus suggestives que les autres. Comme il perturbait les autres moines par ses visions, on l'avait emmurÃĐ dans une caverne sous les montagnes voisines pour l'y laisser mourir. Au fil des annÃĐes, on l'y avait oubliÃĐ. Neuf siÃĻcles plus tard, un soldat anglais avait dÃĐcouvert la caverne par accident. Ãtant les pierres qui en bouchaient l'entrÃĐe, il avait vu sur tous les murs, au plafond et au sol, dans les recoins les plus inaccessibles, sur les aspÃĐritÃĐs et dans les anfractuositÃĐs, dans l'ombre rougeÃĒtre et sur les hÃĐmisphÃĻres mobiles, des formes ÃĐrotiques sculptÃĐes à mÊme la pierre, toutes reprÃĐsentant la mÊme femme. Parfois seule, parfois avec le moine, unis dans des postures impossibles. Le moine avait reproduit dans le noir les corps imaginÃĐs, innombrables de la femme interdite. Il l'avait rÊvÃĐe, caressÃĐe, accouchÃĐe de la pierre. Lorsque ses outils de fortune s'ÃĐtaient brisÃĐs, il avait continuÃĐ Ã la sculpter avec ses ongles et ses doigts et ses dents et son corps, il s'y ÃĐtait frottÃĐ jusqu'à l'usure, jusqu'à ce qu'il y laisse ses fragments et ses os, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de son corps qui ne soit tout entier incrustÃĐ dans ses sculptures. Il avait rÃĐussi à la possÃĐder, mÊme si c'ÃĐtait dans un univers de pierre. Il avait franchi l'espace qui le sÃĐparait du rÊve. Il avait recrÃĐÃĐ la rÃĐalitÃĐ selon ses dÃĐsirs. Il avait rÃĐalisÃĐ ce miracle dont rÊvent tous les artistes ; mais il fallait, pour cela, Être enterrÃĐ vivant.
à la lumiÃĻre, les colorations minÃĐrales de la pierre transformaient les sculptures en fresques peintes : une splendeur dansante, colorÃĐe, joyeuse, jouissive : tel ÃĐtait le tombeau d'Ananda. Âŧ
(p. 125-127)
![]() (2006) DEVI, Ananda, Ãve de ses dÃĐcombres. Paris : Gallimard.
(2006) DEVI, Ananda, Ãve de ses dÃĐcombres. Paris : Gallimard.
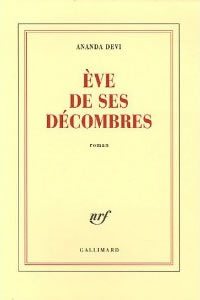 ÂŦ SAD :
ÂŦ SAD :
Je me suis fabriquÃĐ un pont avec un gamin qui avait aussi sa rage au ventre, mÊme s'il ne me saura jamais. Il me dit :
L'ÃĐtoile a pleurÃĐ rose au cÅur de tes oreilles, l'infini roulÃĐ blanc de ta nuque à tes reins et l'homme saignÃĐ noir à ton flanc souverain. Je suis jeune : prenez-moi la main.
J'aime une fille dont on a piÃĐtinÃĐ le corps. Mais le jour oÃđ je serai en elle, j'effacerai toutes ses marques : elle sera neuve. Je suis jeune : j'aime. C'est le soleil entrÃĐ dans mon corps. Elle est l'urgence de ce que j'ÃĐcris. Portraits d'Ãve sur les ÃĐchos de ma chambre. Phrases qui la dessinent, qui la dÃĐclinent. J'aime. Je crois aux possibles. Oui, mÊme ici. MÊme dÃĐvalant nos propres pentes. Un mot me l'a dÃĐcrite, ce jour oÃđ nous sommes descendus à vÃĐlo depuis la Reine de la Paix. Ce jour-là , au moment oÃđ elle m'a dit qu'elle ne dirait jamais je t'aime, j'ai vu le mot qui la dÃĐcrivait, un mot plein de rÃĐsonances et à la fois ÃĐtrange dans ces parages : la grÃĒce. Si cette grÃĒce-là fait partie de mes possibles, ai-je pensÃĐ, je peux tout.
Port Louis me regardait d'un autre Åil. Port Louis la noire, la vilaine, Port Louis dÃĐfigurÃĐe par des formes grotesques, Port Louis l'infranchissable dans ses marÃĐes humaines, j'ai cru qu'elle me faisait de l'Åil. Ses pigeons noirs ponctuant tous les toits ont acceptÃĐ de me dÃĐcoder ses humeurs. La ville me disait : s'il y a des instants comme celui-ci et des visages comme le sien, alors, tu devrais m'aimer, rien que pour cela. Âŧ
(p. 67)
![]() (2003) DEVI, Ananda, Le long dÃĐsir. Paris : Gallimard.
(2003) DEVI, Ananda, Le long dÃĐsir. Paris : Gallimard.
 ÂŦ Mon ÃŪle n'a de sens que par mes rÊves. Je respire de loin l'odeur fumÃĐe des acacias. Un grand ciel sans cassure, des voix d'oiseaux et d'arbres au cÅur mourant, je vous porte et je vous respire. Ils me sereinent.
ÂŦ Mon ÃŪle n'a de sens que par mes rÊves. Je respire de loin l'odeur fumÃĐe des acacias. Un grand ciel sans cassure, des voix d'oiseaux et d'arbres au cÅur mourant, je vous porte et je vous respire. Ils me sereinent.
Ãle profonde, la seule qui compte. Ã sa surface, les gens s'agitent. Ils s'ÃĐloignent de la demi-musique des poÃĻmes ÃĐclos entre ses reins. Leurs yeux se dÃĐrobent ou bien s'aiguisent. Ils ne fredonnent plus. Seul le badaud assis entre deux barriques sifflote encore un air de pluie tandis que les vers lui sortent des orteils. Âŧ
(p. 75)
![]() (2003) DEVI, Ananda, La vie de JosÃĐphin le fou. Paris : Gallimard.
(2003) DEVI, Ananda, La vie de JosÃĐphin le fou. Paris : Gallimard.
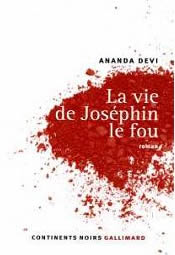 ÂŦ Trop longtemps, j'ai vÃĐcu loin des hommes. Je sais plus comment faire.
ÂŦ Trop longtemps, j'ai vÃĐcu loin des hommes. Je sais plus comment faire.
Je suis sorti, j'ai plongÃĐ dans l'eau à la bouche de la cave pour me retrouver dans la mer et les laisser se calmer et me calmer aussi. Nager longuement, puissamment, grandes brasses, grands coups de jambes pour bien labourer la mer, elle se plaint pas, elle, elle a pas peur de moi, elle sait qui je suis, elle me connaÃŪt, JosÃĐphin qui ferait de mal à personne, JosÃĐphin aux mains qui donnent, aux mains larges pour porter tellement de choses, porter les gros mulets blessÃĐs hors du chemin des requins, et porter les petites filles qui menacent d'Être fracassÃĐes hors du chemin de la vie, les porter toute ma vie, s'il le faut, sur mes ÃĐpaules, s'il le faut, serais prÊt à le faire, mais pourquoi elles peuvent pas comprendre tout ce qui en moi est offert est donnÃĐ est prÊt à se couper en deux pour elles prÊt à se taillader les tendons et les chevilles et les poignets, tout ce qu'elles voudraient de moi, j'offrirais. Au bas, des fleurs de corail s'ouvrent rien que pour moi, des algues s'agitent comme de grandes dames pleines d'envie, ils ont tous envie de moi, mÊme les anguilles qui ce jour-là se sont glissÃĐes partout pour m'explorer et qui m'ont pas fait mal, pourtant elles auraient pu, elles auraient pu me mordre et me laisser tout saignant dans la boue et me manger bout par bout mais elles l'ont pas fait, elles ont senti mon odeur, elles ont respirÃĐ la mer en moi sur mon haleine sur ma langue et elles sont devenues mes amies, je les tue juste pour manger pour devenir un peu comme elles un peu elles, mÊme les murÃĻnes et les requins si dangereux, ils me sentent, ils respirent ma prÃĐsence et ils ont pas peur de moi et j'ai pas peur d'eux, on se respecte, nu ou pas, on est pareil, enfants du mÊme corps, enfants de la mÊme mer. Âŧ
(p. 58-59)
![]() (2002) DEVI, Ananda, Soupir. Paris : Gallimard.
(2002) DEVI, Ananda, Soupir. Paris : Gallimard.
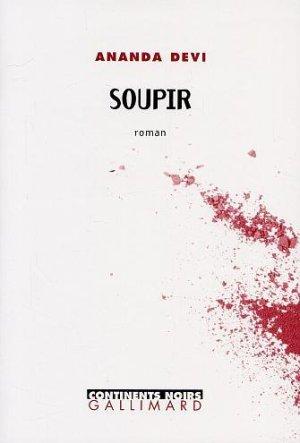 ÂŦ J'entends la douce ravane à l'intÃĐrieur de NoÃŦlla, et le regard qu'elle pose sur moi est, enfin, dÃĐbarassÃĐ de toute haine. ÂŦ Il t'a fallu du temps pour comprendre Âŧ, dit-elle. Je sais. Le chemin vers Soupir a ÃĐtÃĐ long. Et le chemin au-delà de Soupir, encore plus. Mais nous y sommes. Nous sommes arrivÃĐs. Nous sommes en face du bleu-noir de notre destin, comme la femme de la charette, et nous comprenons qu'il n'y a plus qu'un pas à faire. En nous penchant dans l'air ÃĐblouissant, nous voyons trÃĻs clairement, au bas de la colline, les cercueils gravÃĐs de nos noms qui nous attendent.
ÂŦ J'entends la douce ravane à l'intÃĐrieur de NoÃŦlla, et le regard qu'elle pose sur moi est, enfin, dÃĐbarassÃĐ de toute haine. ÂŦ Il t'a fallu du temps pour comprendre Âŧ, dit-elle. Je sais. Le chemin vers Soupir a ÃĐtÃĐ long. Et le chemin au-delà de Soupir, encore plus. Mais nous y sommes. Nous sommes arrivÃĐs. Nous sommes en face du bleu-noir de notre destin, comme la femme de la charette, et nous comprenons qu'il n'y a plus qu'un pas à faire. En nous penchant dans l'air ÃĐblouissant, nous voyons trÃĻs clairement, au bas de la colline, les cercueils gravÃĐs de nos noms qui nous attendent.
Cela ne nous effraie pas. Ce que nous ressentons à ce moment-là , c'est ce dÃĐchirement d'amour qui accompagne tout adieu. Âŧ
![]() (2001) DEVI, Ananda, Pagli. Paris : Gallimard.
(2001) DEVI, Ananda, Pagli. Paris : Gallimard.
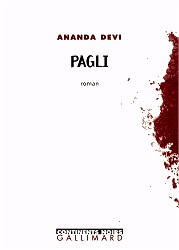 ÂŦ Tu as parcouru toutes les ÃŪles.
ÂŦ Tu as parcouru toutes les ÃŪles.
Tu les connais toutes. Rocailleuses, basaltiques, escarpÃĐes ou plates, arides ou vertes, tu les connais toutes et tu les aimes.
Un soir d'ÃĐtoiles tu me parles des ÃŪles.
Points d'espace. La mangrove t'enlise. Tu t'allies aux pÊcheurs de là -bas, qui n'ont que leurs casiers et leurs lignes pour vivre. Le cocotier est leur mÃĻre nourriciÃĻre. Il leur donne ses noix, son lait, ses fibres, son copra. Le cocotier est la divinitÃĐ de leur vie. DÃĻs l'enfance, ils connaissent chaque arbre et lui donnent un nom secret. La beautÃĐ des ÃŪles n'a d'ÃĐgal que leur fragilitÃĐ. DÃĻs l'enfance, ils savent que leurs jours sont comptÃĐs.
Et pourtant, c'est là qu'est l'ÃĐternitÃĐ, me dis-tu. C'est là que la vie prend son sens. Chaque seconde gorgÃĐe de soleil et de mer est comme un fruit qu'il faut tout de suite manger, avant qu'il se mette à pourrir.
Un jour, me dis-tu, nous irons manger la noix de coco à Agalega. Nous irons vivre là -bas et je serai ton pÊcheur et toi ma femme qui t'attend. Âŧ
(p. 71)
![]() (2000) DEVI, Ananda, Moi, lÂīinterdite. Paris : Ãd. Dapper.
(2000) DEVI, Ananda, Moi, lÂīinterdite. Paris : Ãd. Dapper.
 ÂŦ Les arbres ne cessaient de fleurir autour de nous et les oiseaux de chanter les quatre mÊmes notes, mÊme si le reste de l'ÃŪle se dÃĐsagrÃĐgeait. Les cyclones la frappaient à prÃĐsent en toute saison, dÃĐvastaient les rÃĐcoltes et dÃĐchaÃŪnaient les marÃĐes, mais nous ÃĐtions intacts et protÃĐgÃĐs. Notre soleil intÃĐrieur continuait de briller et la lumiÃĻre s'ÃĐchappait de nos corps rongÃĐs de rouilles, de nos regards hantÃĐs de nous-mÊmes. Nous devenions transparents comme du verre, et la beautÃĐ des choses se deversait à l'intÃĐrieur de nous comme un liquide. Nous regardions les gens sombrer dans le dÃĐsespoir et voir le renouveau des bÊtes qui les prenaient d'assaut, et cependant, rien ne pouvait nous toucher. Âŧ
ÂŦ Les arbres ne cessaient de fleurir autour de nous et les oiseaux de chanter les quatre mÊmes notes, mÊme si le reste de l'ÃŪle se dÃĐsagrÃĐgeait. Les cyclones la frappaient à prÃĐsent en toute saison, dÃĐvastaient les rÃĐcoltes et dÃĐchaÃŪnaient les marÃĐes, mais nous ÃĐtions intacts et protÃĐgÃĐs. Notre soleil intÃĐrieur continuait de briller et la lumiÃĻre s'ÃĐchappait de nos corps rongÃĐs de rouilles, de nos regards hantÃĐs de nous-mÊmes. Nous devenions transparents comme du verre, et la beautÃĐ des choses se deversait à l'intÃĐrieur de nous comme un liquide. Nous regardions les gens sombrer dans le dÃĐsespoir et voir le renouveau des bÊtes qui les prenaient d'assaut, et cependant, rien ne pouvait nous toucher. Âŧ
(p. 108-109)
![]() (1993) DEVI, Ananda, Le voile de Draupadi. Paris : LÂīHarmattan.
(1993) DEVI, Ananda, Le voile de Draupadi. Paris : LÂīHarmattan.
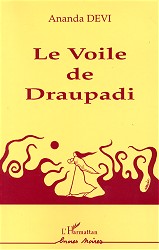 ÂŦ Nous avons roulÃĐ en silence jusqu'à l'extrÃĐmitÃĐ sud-ouest de l'ÃŪle. On ne peut pas aller plus loin. L'ocÃĐan est dÃĐjà là , à nos pieds, et le collier de rÃĐcifs s'interrompt ici pour laisser pÃĐnÃĐtrer des formes liquides d'une rare violence et si minutieusement sculptÃĐes qu'on peut à peine leur donner le nom de vagues.
ÂŦ Nous avons roulÃĐ en silence jusqu'à l'extrÃĐmitÃĐ sud-ouest de l'ÃŪle. On ne peut pas aller plus loin. L'ocÃĐan est dÃĐjà là , à nos pieds, et le collier de rÃĐcifs s'interrompt ici pour laisser pÃĐnÃĐtrer des formes liquides d'une rare violence et si minutieusement sculptÃĐes qu'on peut à peine leur donner le nom de vagues.
Le temps est clair en cette rÃĐgion, le soleil dÃĐclinant ne brÃŧle plus le ciel mais s'y dilate en une vaste incandescence. Les gerbes d'eau gravissent nerveusement les rochers et se cabrant par-dessus, se mÃĐlangent aux gerbes de lumiÃĻre dÃĐversÃĐes du ciel. Les mÊmes bruits d'eau et de vent nous entourent de toutes parts, se liguant pour siffler ou chuchoter ou geindre dans les cavitÃĐs des rochers habitÃĐs de leur propre musique. Ces hauts rochers, voÃŧtÃĐs comme des cathÃĐdrales dont la pieuse et craintive populace se rÃĐfugie au moindre son ÃĐtranger, en un crissement de pattes et de pinces, dans ses abris sous-marins, portent en eux une tout autre mÃĐmoire que celle des habitants de l'ÃŪle. Ils ont ÃĐtÃĐ là au tout dÃĐbut, ils ont connu le frÃĐmissement des gaz et des ÃĐnergies comprimÃĐs sous la voute terrestre, ils ont connu la fureur des explosions telluriques, les coulÃĐes de lave qui, à chaque refroissement, se solidifiaient et devenaient un sol, un espace et une aire oÃđ les hommes trouveraient un jour un point de rencontre et de repos. Âŧ
(p. 82)
![]() (1992) DEVI, Ananda, La fin des pierres et des ÃĒges. Maurice : Ãd. de l'OcÃĐan Indien.
(1992) DEVI, Ananda, La fin des pierres et des ÃĒges. Maurice : Ãd. de l'OcÃĐan Indien.
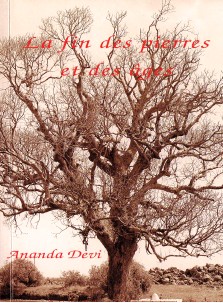 ÂŦ Cela fait plusieurs nuits quâon sâexerce. Il faut bien que lâharmonie soit rÃĐalisÃĐe avant et comprise dans son ensemble. LâexÃĐcution du ballet nâen est que plus exaltante, plus ponctuelle, plus intuitivement rythmÃĐe. Puisque nous ne disposons que de quelques heures, dâun temps trÃĻs limitÃĐ par dâinsolites contingences, cela vaut la peine dây mettre tout lâeffort requis (p. 93).
ÂŦ Cela fait plusieurs nuits quâon sâexerce. Il faut bien que lâharmonie soit rÃĐalisÃĐe avant et comprise dans son ensemble. LâexÃĐcution du ballet nâen est que plus exaltante, plus ponctuelle, plus intuitivement rythmÃĐe. Puisque nous ne disposons que de quelques heures, dâun temps trÃĻs limitÃĐ par dâinsolites contingences, cela vaut la peine dây mettre tout lâeffort requis (p. 93).
On attend une heure prÃĐcise. Une heure ? Non. PlutÃīt une minute, une sÃĐquence de secondes parmi lesquelles une seule contiendra la combinaison exacte, la mise en marche du mouvement de rotation, comme une orbite enchaÃŪnÃĐe à sa planÃĻte. Âŧ
(p. 93)



